Il est question dans cet article de développer une réflexion sur une pratique qui contribue merveilleusement à la circulation des idées entre les différentes civilisations à travers les temps et au-delà des frontières, à savoir la traduction. Il n’en demeure pas moins que cet acte est confronté à maints écueils, surtout quand il s’agit de textes littéraires, et en l’occurrence de la poésie. Le poème a en fait ses exigences et ses spécificités puisqu’il « est l’ensemble de voix, de rythmes et de sonorités qui coexistent dans une harmonie créative[1] ». La traduction est sans cesse confrontée à une tension créatrice entre deux « systèmes sémantiques » tout à fait différents, d’où l’idée suivant laquelle la traduction serait une véritable expérience des limites[2], engageant par ailleurs d’autres paradigmes, notamment « les limites de l’interprétation [3]», « la domestication [4]», et les intraduisibles en philosophie, « c’est-à-dire les mots qu’on n’arrive pas à rendre dans une autre langue, qui sont caractéristiques d’une langue et qui la signalent dans sa différence : en somme, des symptômes de la différence des langues [5]». Ces faits méritent toutefois que nous nous interrogeons sur leur validité aussi bien pour la philosophie que pour la littérature. Il s’agit à vrai dire de l’une des conceptions de la traduction qui met en avant cette impossibilité de tout traduire, mais qui sera néanmoins mise en confrontation avec d’autres théories.
Pour peu que cet article puisse saisir les points névralgiques de la traduction ainsi que ses paradoxes, il importe de nous situer par rapport aux théories de la traduction et de ne point nous contenter d’une seule vision quoiqu’elle permette peu ou prou de nuancer les différentes positions des traducteurs. Sera exposée en amont la définition – sans exhaustivité aucune – du théoricien italien Umberto Eco qui sera interpellé tout au long de cet article en raison de ses positions qui sont en concordance avec la thèse que cet article défend. Ses positions théoriques concernant l’activité de traduction sont d’une telle nuance qu’elles témoignent d’une justesse remarquable, et si elles sont admises comme telles, c’est parce qu’Umberto Eco part de son expérience de traducteur et de son savoir théorique caractérisée par une érudition vertigineuse. « Que signifie traduire ? On aimerait donner cette première réponse rassurante : dire la même chose dans une autre langue [6]». Telle est la définition préliminaire proposée par Umberto Eco, bien que ce dernier ait apporté de nombreuses nuances tout au long de son essai. Encore faudrait-il reprendre une autre définition qui est d’une fécondité épistémologique fort intéressante et qui a le mérite de placer la critique du côté de la réception : « traduire signifie comprendre le système intérieur d’une langue et la structure d’un texte donné dans cette langue, et construire un double du système textuel qui, sous une certaine description, puisse produire les mêmes effets analogues chez le lecteur, tant sur le plan stylistique, métrique, phonosymbolique…[7]». Nous pensons dans cette perspective que « le traducteur doit accomplir des tâches difficiles, dont la plus importante est de transmettre à l’oreille réceptrice la magie associée à la musique des mots, due en grande partie aux effets de rythme et de rimes [8]».D’ailleurs, il nous a paru intéressant de partir de l’acception d’Umberto Eco pour développer une lecture critique de la nouvelle traduction du roman de Béchir Khraïef, Barg Ellil (برڨ اليل)[9] assurée par l’éminente professeure Samia Kassab-Charfi. À cet effet, le propos qui suit s’intéressera à la traduction du roman Barg Ellil de Béchir Khraïef, parue chez Sud Editions, ce qui a constitué d’ailleurs un évènement et la consécration d’un romancier, qui est l’un des pionniers d’une modernité littéraire[10], et de la littérature tunisienne dont l’Histoire est marquée par plusieurs écrivains d’une diversité inouïe[11]. Il ne s’agit pas en revanche de la première traduction, puisqu’il en existe une autre[12] parue aux éditions Arabesques, sauf que cette traduction est passée presque inaperçue pour diverses raisons et seul un article d’ordre journalistique[13]lui a été consacré. À la différence de la première traduction, la nouvelle a joui d’un accueil journalistique très favorable[14], et à titre d’exemple, nous mentionnons l’article publié par Nawaat.
La traductrice, qui dispose d’un savoir théorique étendu sur le sujet de la traduction, a mentionné, lors d’un passage médiatique[15], le linguiste et théoricien de la traduction Antoine Berman qui est, selon elle, son maître à penser en matière de traduction. Ce nom nous était complètement méconnu et, en toute urgence, nous nous sommes procuré ces deux essais dédiés à la théorie de la traduction, à savoir L’Épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin. (Gallimard, Coll. « Essais », 1984) et La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain (Seuils, 1999). Nous avons consulté les deux essais dont nous avons exploités quelques concepts opératoires, notamment Weltlïteratur qui est traduit par « littérature mondiale ».
La traduction du roman de Béchir Khraïef serait une illustration de ce concept de Weltlïteratur, « littérature mondiale », qui est apparu chez les romantiques allemands, et « auquel [Goethe] a donné ses titres de noblesse [16]». L’une des notions qui font valoir la toute-puissance de la traduction est en fait cette espèce de rapport que l’on entretient avec l’étrangeté et l’altérité. Cela suppose d’une manière ou d’une autre une [re]connaissance de notre étrangeté – fussions-nous étrangers à nous-mêmes [17]? – et de nos particularismes culturels[18]. À ce titre, la relecture du roman dans la langue d’arrivée est une sorte de regard opposé à celui qui est imprégné d’exotisme et loin de tout égocentrisme, et il s’agit à vrai dire d’un inversement de rôle où le récepteur d’une culture différente sera confronté à une étrangeté singulière, afin d’accéder à une altérité qui est actualisée par l’acte de lecture. Cela est susceptible de favoriser, en dépit de tout, l’échange culturel comme le pense d’ailleurs Antoine Berman : « La traduction est l’acte sui generis qui incarne, illustre et aussi permet ces échanges, sans en avoir bien entendu le monopole [19]». Sa pensée rejoint l’idée de Paul Ricœur où l’accès à l’ipséité et à la mêmeté passe tout d’abord par l’altérité, si bien que ce processus participe de la construction de l’identité : « Il existe une multiplicité d’actes de translation qui assurent la plénitude des interactions vitales et naturelles entre les individus, les peuples et les nations, interactions dans lesquelles ceux-ci construisent leur identité propre et leurs rapports avec l’étranger »[20]. Pour que nous ne soyons pas déroutés par ces spéculations théoriques sur la question de l’identité, il convient de considérer deux niveaux, à savoir la traduction des passages écrits en dialecte tunisien et le style avec lequel ils ont été traduits – étant les deux en corrélations –, lesquels, nous semble-t-il, sont révélateurs de la transposition d’une identité culturelle sans qu’il n’y ait, à notre humble avis, de pertes[21]. Pour mettre cette pensée à l’œuvre, nous procédons par commenter et discuter des exemples tirés de la traduction de Samia Kassab-Charfi, notamment les dialogues qui sont en dialectal.
Dans sa présentation, Samia Kassab-Charfi a déjà souligné le pluralisme linguistique dont foisonne l’œuvre, d’où le choix du sous-titre Les langues de Béchir Khraïef, ce qui constitue un vœu/aveu de la place privilégiée qu’occupe le dialecte tunisien. Elle fait remarquer d’ailleurs que « dans Barg Ellil comme dans bien d’autres de ses romans et nouvelles, la plupart des dialogues sont en dialectal, ce qui sauvegarde la saveur des expressions idiomatiques, avec les exclamations et la tonalité subjective, les jurons et la gouaille populaire… [22]». À cet effet, la traduction du dialecte tunisien vers une autre langue d’accueil, en l’occurrence le français, ne s’est pas faite dans l’aisance que l’on imaginait, d’autant plus que certaines expressions qui appartiennent, d’une part, à une langue vernaculaire de l’époque de l’écriture du roman, et, d’autre part, à l’époque représentée par le romancier Béchir Khraïef, c’est-à-dire le Tunis du XVIe siècle, renvoient à des représentations sociales[23] propres à un contexte local. L’un des exemples notoires figure dans le dialogue entre l’épouse et son mari qui s’apprête à partir en pèlerinage (la première partie du roman). La réplique du mari traduite fournit des enseignements qui ne sont pas négligeables :
- Ô femme de bon lignage, j’aspire de tout mon cœur à accomplir le pèlerinage sacré de la Mecque. Vois donc de quoi tu pourrais avoir besoin car je vais emmurer la porte de la maison.[24]
– يا بنت الناس إشتاق قلبي إلى حج بيت الله الحرام، شوفي ما يصلح بيك بش نبني عليك باب.
Le mari, dans cette réplique, use d’une expression qui a son ancrage socio-culturel, et dont la traductrice a su garder la spécificité identitaire, quoique transposée vers la langue française dont l’imaginaire culturel ne conçoit pas les rapports matrimoniaux de la même manière. Ainsi, l’expression choisie par la traductrice, à savoir « Ô femme de bon lignage », met en valeur deux caractéristiques : l’idée de filiation (bien que l’expression « enfant de lignage » soit utilisée aussi dans le domaine de la psychanalyse) et la considération éthique qui est relative aux mœurs (signifié par l’emploi de l’adjectif « bon »). S’agirait-il dans ce cas d’un enrichissement par l’ajout de l’épithète « bon » pour compenser une certaine perte de sens, puisque le fait de traduire l’expression par « femme de lignage » ne rend pas compte avec justesse de la véritable signification de l’expression dialectale ? Difficile d’en assurer une réponse, mais ce dont nous sommes certains c’est que cette traduction découle en fait d’une interprétation juste et d’une connaissance de la signification de l’expression qui sous-entend des aprioris socio-culturels. La question de taille, dans le cas échéant, est de savoir si la composante de l’oralité est préservée, malgré tout, dans un espace de réception différent. Bien évidemment, la tournure phrastique favorise une fluidité qui produit cet effet d’oralité, ce tissu textuel. Un autre exemple pourrait renseigner sur cet effort de préservation de l’oralité.
- Denguir, Harbaoui, Abacha, venez vite servir votre seigneur !
Les jeunes esclaves entrèrent dans la chambre, balayant et remettant de l’ordre. Baba Saâfane enchaîna :
- Monseigneur désire-t-il quelque chose ?
- Je désire ce que peut désirer un homme affamé et absent de son pays depuis plusieurs années.
L’aubergiste sourit et ordonna :
- Un couscous béjois à l’agneau, avec son lait caillé !
- Que Dieu bénisse tes paroles, frère. Et surtout ne tarde pas ![25]
– دنغير، حرباوي، عبشة، قوموا لخدمة سيدكم.
دخل الغلمان الحجرة يكنسون و يرتبون. سأل بابا سعفان:
– يشثهيش سيدي حاجة ؟
– نشتهي ما يشتهي راجل جيعان وغايب على تونس سنين.
إبتسم صاحب الفندق وقال:
– كسكسي باجي و اللبن الرايب.
– الله يرحم فمك يا ولد بلادي، عجل.
Nous avons choisi cet exemple, puisque la traduction n’est pas aussi évidente, en raison du dialogue qui est écrit en dialecte tunisien ; et ce qui rend encore la tâche plus difficile est la présence d’une expression propre au parler tunisien. En effet, le verbe « قوموا » qui est de type injonctif et qui relève de l’oral échapperait probablement à un locuteur non-natif qui aurait traduit l’expression par « levez-vous », puisque le verbe acquiert sa signification du contexte et de toute la scène représentée, ce qui suppose l’idée de la vitesse, et c’est pour cette raison que la traductrice a choisi le verbe « venez » qu’elle a enrichi avec l’adverbe « vite ». Cela a permis de préserver la dimension orale de cette scène. Dans le même exemple, la traduction n’a pas manqué de faire valoir l’enjeu de l’interprétation, surtout que l’expression dialectale qui exprime le souhait dans le texte dans sa langue première est marquée par un usage métonymique « الله يرحم فمك», d’où le choix de l’expression « paroles » au lieu de « bouche ».
La traduction de Barg Ellil par Samia Kassab-Charfi serait considérée comme une expérience des limites dans la mesure où elle a pu franchir les limites marquées par les intraduisibles, mot cher à Barbara Cassin. Aussi la traductrice s’est-elle accordé le privilège de proposer une lecture tout à fait neuve du roman de Béchir Khraïef comme nous le soulignerons ci-après. Du côté de la traduction, il importe que nous nous attardions sur le discours liminaire qui, sans lequel, la traduction eût peut-être été lacunaire. Le discours liminaire et le paratexte comportent la présentation et les notes de bas de page. Se pencher sur le discours liminaire – ou le seuil du texte selon la terminologie de Gérard Genette – de la traduction a bien ses vertus dans la mesure où ce dernier fournit des éléments qui sont susceptibles d’apporter des explications, des éclaircissements, voire des interprétations, comme c’est le cas de la Présentation élaborée par la traductrice Samia Kassab-Charfi. Il s’agit à vrai dire d’un discours préfaciel qui fait office d’un discours à la fois actualisant et critique, comme l’a bien défini Gérard Genette en distinguant l’introduction de la préface : « Les préfaces […] se multiplient d’une édition en édition et tiennent compte d’une historicité plus empirique ; elles répondent à une nécessité de circonstance… »[26]. Les fonctions de la présentation qui s’apparente à une préface sont multiples, dont la valorisation[27] de l’auteur Béchir Khraïef et du roman Barg Ellil. La traductrice renvoie d’ailleurs à la présentation qu’avait consacrée Fawzi Zmerli à la version arabe de Barg Ellil, paru dans la même maison d’édition. La Présentation de Samia Kassab-Charfi, qui fait preuve d’une connaissance impressionnante, propose une lecture de l’œuvre en s’appuyant d’une part sur des travaux académiques et d’autre part sur des champs de critiques pluridisciplinaires en mettant en œuvre le concept de créolisation que l’on doit à Edouard Glissant, ce qui constitue un regard tout à fait neuf pour appréhender l’œuvre dans sa dimension plurielle et universelle. La présentation aborde cinq axes qui rendent compte de l’essentiel de l’esthétique de Béchir Khraïef, au moins pour cette œuvre. On ne peut toutefois pas être indifférent à l’égard de la citation[28] de Marcel Proust placée en exergue de la présentation ; cette citation cristallise l’idée d’émancipation et de délivrance qui est le propre du personnage éponyme du roman. D’ailleurs, la métaphore d’Orphée déployée par la traductrice établit avec justesse une correspondance entre Barg Ellil, le personnage principal, et l’Orphée noir de la fameuse Préface[29] de Jean-Paul Sartre.
Le premier trait de cette esthétique de Béchir Khraïef est donc la capacité dont est doté ce dernier à saisir l’hétérogénéité de la société tunisienne au XVIe siècle par le style ; Béchir Khraïef qui réussit, souligne Samia Kassab-Charfi, à « marier la plus grande légèreté de ton à la profondeur la plus philosophique, l’humour malicieux à la gravité saisissante d’un moment mélancolique [30]». Le mérite de cette première section de la Présentation est d’avoir attiré l’attention sur l’Histoire de la Tunisie qui constitue la toile de fond du roman. Cette mise en avant de la dimension historique, qui a déjà été soulignée par Fawzi Zmerli, témoigne du travail de recherche approfondie et de la fouille minutieuse dans les méandres de l’Histoire, ce que les autres éléments paratextuels, notamment les notes infrapaginales, confirmeront. Force est de constater que, dans cette traduction, les notes de bas de page sont d’autant plus importantes qu’il serait judicieux qu’on s’y attarde, et pour cause : cet « appareil paratextuel » cherche à rendre la traduction la plus fidèle possible du texte traduit en compensant les pertes[31] auxquelles chaque traduction est confrontée. Ces notes infrapaginales où « on trouve des définitions ou explications de termes employés dans le texte, parfois l’indication d’un sens spécifique ou figuré [32]» servent non seulement à rendre le texte plus compréhensible, mais également à témoigner du travail de recherche élaboré par la traductrice. Cela n’est point étonnant en raison des exigences, notamment académiques, desquelles Samia Kassab-Charfi ne s’est pas détournée. L’on peut d’ailleurs qualifier cette pratique consistant à rédiger des notes qui « comme la préface, [peuvent] apparaître à n’importe quel moment de la vie du texte, pour peu qu’une édition en offre l’occasion [33]», de pratique savante. Cela représente à vrai dire une vertu et un apport d’une grande considération destiné à favoriser l’extension de l’espace de réception. En nous appuyant en outre sur la définition de Gérard Genette, il est possible de répartir les soixante-dix-sept notes qui sont placées à la fin du texte selon leur fonction, puisqu’elles comportent tantôt des notes qui fournissent des définitions des mots et expressions, et tantôt des notes qui éclairent sur des épisodes historiques, comme c’est le cas de la première note où la traductrice renseigne le lecteur quant à un épisode tragique de l’Histoire de la Tunisie marqué par le massacre des Tunisiens par l’armée de Charles Quint au XVIe siècle. Plusieurs exemples de notes sont d’un intérêt majeur, puisqu’elles mettent en avant la fouille quasi archéologique dans les références notamment historiques du roman, en l’occurrence la dix-huitième note de la traduction. Cette note offre une explication d’ordre ethnologique et sociologique qui favorise une meilleure compréhension du texte dans sa langue d’arrivée. En plus de cette explication du contexte, un renvoi à une autre œuvre, notamment Bellara de Béchir Khraïef, attire l’attention sur la circularité des références dans les romans de ce grand écrivain.
[1]Haytham Jarboui, « Traduire la poésie ou le défi du sens », In Traduire n’est pas trahir, Bulletin des Journées Poétiques de Carthage (1ère session), Ministère des affaires culturelles, n°6, 27 mars 2018, p. 9.
[2]L’expérience des limites est un concept philosophique et c’est aussi l’expérience substantielle de la littérature : « la littérature est dans son essence la plus profonde expérience des limites. Qu’il s’agisse de l’expérience du mal chez Bataille, du dehors chez Blanchot ou l’écriture comme processus de déterritorialisation chez Deleuze, il est bien question d’une intuition commune. La pensée contemporaine l’a bien pressenti. Les puissances inouïes du réel, qui frappent l’homme de plein fouet, le poussent à se confronter à ses limites : limites de la conscience, limites du corps, limites de la raison, limites de l’humanité même de l’Homme ». (Mohamed Harmal, Murakami et la logique du rêve. Suivi de Sur la littérature et l’expérience-limite, Tunis, Nirvana, 2021, p. 5). En d’autres termes, l’expérience des limites est cette idée de dépassement de toutes limites et de cette capacité d’aller au-delà de cet impossible. Par ailleurs, la traduction est en quelque sorte l’une des formes de l’expérience des limites. Toutefois, cette idée n’est pas neuve, parce que nous l’empruntons à un titre d’un ouvrage de Mounira Chatti qui a abordé cette idée dans L’écriture comme expérience des limites. Les écritures franco-arabes (Presses Universitaires de Bordeaux, Coll. « Leçon de Sciences Aquitaine », 2016).
[3]La traduction est tributaire d’un acte non moins important qui est l’interprétation. Il est à faire remarquer que certains énoncés peuvent être traduits littéralement – bien que traduire littéralement ne soit pas sans risques, notamment celui de rendre l’énoncé d’accueil caricatural, voire risible. À ce titre, Umberto Eco fait remarquer que « toute discussion sur la liberté de l’interprétation s’ouvre obligatoirement sur une défense du sens littéral » (Les limites de l’interprétation, Paris, Grasset, p. 35). D’autre part, Umberto Eco nous rappelle le positionnement de Jacques Derrida : « Derrida lui-même, dans la Grammatologie, rappelle que, sans la totalité des instruments de la critique traditionnelle, la lecture risque de se développer tous azimuts et de permettre toutes les interprétations possibles. Naturellement, ayant évoqué ce nécessaire garde-fou de l’interprétation, il ajoute que cela protège la lecture sans l’ouvrir pour autant » (Ibid., p. 36). Alors que d’autres énoncés où l’auteur fait recours à un discours imagé par les métaphores en l’occurrence nécessitent une interprétation pour saisir l’intentionnalité de l’auteur. Umberto Eco met en garde en revanche contre la surinterprétation au risque de dénaturer l’énoncé dans la langue du texte originel, et par conséquent la traduction sera erronée.
[4]Par domestication ou familiarisation, Umberto Eco cherche à expliquer les phénomènes de traduction qui tentent de faire adapter la traduction à un espace de réception donné et ne manque pas de donner des exemples qui rendent compte de l’expérience de traduction dont ses romans ont fait l’objet notamment La pendule de Foucault et Le nom de la rose. En revanche, Umberto Eco n’hésite pas à louer les vertus de la « défamiliarisation » qui est susceptible de faire valoir l’« étrangeté » : Humboldt (1816) a proposé une différence entre Fremdheit (qu’on pourrait traduire par « étrangeté ») et Das Fremde (à traduire comme « l’étranger »). Peut-être n’avait-il pas bien choisi ses termes, mais sa pensée me paraît claire : le lecteur sent l’étrangeté quand le choix du traducteur semble incompréhensible, comme s’il s’agissait d’une erreur, il sent en revanche l’étranger quand il se trouve face à une façon peu familière de lui présenter quelque chose qu’il pourrait reconnaître, mais qu’il a l’impression de voir pour la première fois. Je crois que cette idée de l’étranger n’est pas si éloignée que cela de « l’effet de défamiliarisation » des formalistes russes, un artifice grâce auquel l’artiste conduit le lecteur à percevoir la chose décrite sous un angle et une lumière différente, si bien qu’il la comprend mieux que jamais. (Dire presque la même chose. Expérience de traduction (traduit de l’italien par Myriam Bouzaher), Paris, Grasset, Coll. « Livre de poche », 2006, p. 118).
[5]Barbara Cassin, Plus d’une langue, Paris, Bayard, Coll. « Les petites conférences », 2019, p. 14.
[6] Umberto Eco, Dire presque la même chose. Expérience de traduction (traduit de l’italien par Myriam Bouzaher), Paris, Grasset, Coll. « Livre de poche », 2006, p. 7.
[7]Ibid. p. 17.
[8]Haytham Jarboui, Op. Cit, p. 9.
[9]البشير خريف، برڨ اليل (تقديم فوزي الزمرلي)، تونس، دار الجنوب للنشر، سلسلة » عيون المعاصرة« ، 2022.
[10]Dans sa présentation, Samia Kassab-Charfi a attiré l’attention sur tous les aspects qui définissent le caractère moderne de ce roman, à commencer par l’aspect de la diversité et de la pluralité des registres de langues, des ethnies et des cultures, ce qui fait penser immédiatement à la notion de dialogisme forgée par Michail Bakhtine. Il ne s’agit pas seulement de cet aspect que la traductrice a fait apparaître au grand jour, mais également la dimension créole, intersectionnelle, et féministe, puisque la traductrice connaît très bien les littératures antillaises et négro-africaines et maîtrise parfaitement les théories du genre (the gender stadies) et les approches de l’analyse des textes littéraires.
[11]Samia Kassab-Charfi, Adel Khedher, Un siècle de littérature tunisienne (1900-2017), Paris, Honoré Champignon, 2020.
[12] Béchir Khraief, Barg Ellil (traduit de l’arabe par Ahmed Guesmi), Tunis, éd. Arabesques, 2017.
[13]Ahmed Mahfoudh, « Le retour de Barg Ellil », in Les Lettres Tunisiennes (revue électronique). Lien http://www.lettrestunisiennes.com/index.php/notes-de-lecture/34-articles-de-lecture/224-le-retour-de-barg-ellil. Consulté le 22 avril 2023.
[14]Nous avons recensé au moins quatre articles de presse : « Barg Ellil : Traduit de l’arabe par Samia Kassab-Charfi », Leaders (2023), paru le 24 avril 2024. Lien : https://www.leaders.com.tn/article/34696-barg-ellil-de-bechir-khraief-traduit-de-l-arabe-par-samia-kassab-charfi. Consulté le 24 avril 2024 ; « Littérature tunisienne : une nouvelle traduction en français de Barg Ellil de Béchir Khraïef », Kapitalis, paru le 8 mars 2023. Lien : https://kapitalis.com/tunisie/2023/03/08/litterature-tunisienne-une-nouvelle-traduction-en-francais-de-barg-ellil-de-bechir-khraief/. Consulté le 24 avril 2023 ; « Une nouvelle traduction française de “Barg Ellil” de l’immense écrivain Béchir Khraïef par Samia Kassab-Charfi », L’Observatoire Européen de Plurilinguisme, paru le 24 mars 2023. Lien. https://www.observatoireplurilinguisme.eu/ro/pol-cercetare/lans%C4%83ri/16300-une-nouvelle-traduction-fran%C3%A7aise-de-barg-ellil-de-l%E2%80%99immense-%C3%A9crivain-b%C3%A9chir-khra%C3%AFef-par-samia-kassab-charfi. Consulté le 24 avril 2023.
[15]Escales de Hatem Bouriel, 2023, présenté par Hatem Bouriel, 21 mars 2023, Tunis, RTCI. URL : https://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/videos/5914272528667995. Consulté le 24 avril 2024.
[16] Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin, Paris, Gallimard, Coll. « Essais », 1984, p. 89.
[17] Nous faisons allusion à l’essai de Julia Kristeva, Etrangers à nous-mêmes (Paris, Gallimard, Coll. « Essais », 1991). Nous pensons également à l’essai de Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre. Points, Coll. « Poche », 2015)
[18] Michel Serres ne voit aucune contradiction entre culture locale et culture globale. Par ailleurs, il qualifie le phénomène de rencontre des cultures de relation de « voisinage », et, selon lui, voyager dans une culture différente, c’est aller à la rencontre de l’étranger et de l’altérité : « Ce chemin d’une culture à l’autre est jalonné d’obstacles, et il est difficile de rencontrer autrui, qui, souvent, n’est pas celui que nous croyons. Il ne se révèle pas toujours aussi facile qu’on le croit d’accéder à sa langue, à ses usages et à ses croyances. On peut néanmoins, dans ce parcours, être séduit et découvrir des habitudes qui nous sont étrangères. Qu’y a-t-il de plus beau que l’artisanat brésilien ou de plus extraordinaire, à certains égards, que la finesse de la culture japonaise ? La culture n’a pas de frontière : elle est poreuse. Jamais la France ne fut aussi française qu’au XVIIe siècle, alors que Molière fut largement inspiré par les Italiens, ou Corneille par les Espagnols ». (Michel Serres, « Entre Disneyland et les ayatollahs »,Le Monde Diplomatique, septembre 2001, p. 6. Lien : https://www.monde-diplomatique.fr/2001/09/SERRES/8053)
[19]Antoine Berman, Op.Cit, p. 89.
[20]Ibid.
[21] La notion de perte est observée dans certains cas où la traduction se révèle impossible si bien que le traducteur procède de différentes manières, soit par enrichissement du texte ou par un saut du texte jugé intraduisible suite à un accord entre les parties, à savoir l’auteur et le traducteur : «Très souvent, lorsqu’une traduction adaptée se révèle impossible, l’auteur autorise le traducteur à sauter le mot ou la phrase entière, s’il se rend compte que, dans l’économie générale de l’œuvre, la perte est négligeable. L’exemple type est l’énumération de termes étranges et désuets (technique à laquelle je recours fréquemment). Si une énumération comprend dix termes, dont un intraduisible, on peut la réduire à neuf termes sans que ce soit grave. » (Umberto Eco, Dire presque la même chose. Expérience de traduction (traduit de l’italien par Myriam Bouzaher), Paris, Grasset, Coll. « Livre de poche », 2006, pp. 124-125.)
[22]Béchir Khraïef, Op.Cit, p. 21.
[23]Durkheim définit les représentations (individuelles / collectives) « comme croyances et valeurs communes à tous les membres d’une société, intrinsèquement distinctes de l’addition des représentations de ces individus » (Isabelle Danic. La notion de représentation pour les sociologues. Premier aperçu. éd. V. Goueset, ESO-Espaces et Sociétés, UMR, 2006, vol. 6590, p. 4.). Quant aux représentations collectives, elles « correspondent, selon Durkheim, à la manière dont cet être spécial qu’est la société pense les choses de son expérience propre » (Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Le Livre de poche, 1991, p. 722.). Selon le même théoricien, « les représentations qui en sont la trame se dégagent des relations qui s’établissent entre les individus ainsi combinés ou entre les groupes secondaires qui s’intercalent entre l’individu et la société totale » (Émile Durkheim, Édition électronique réalisée à partir de la Revue de Métaphysique et de Morale, 1898, vol. 6, n° 3, p. 273-302. Lien : http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.due.rep1, p. 19. Consulté le 24 avril 2023). Le concept durkheimien, développé ensuite par Moscovici (Serge Moscovici, « Des représentations collectives aux représentations sociales : éléments pour une histoire », Les représentations sociales, 1989, vol. 5, p. 79-103), nous permet d’appréhender et de comprendre la représentation de soi, la représentation de l’autre (l’altérité) et la représentation du monde (le versant idéologique).
[24]Béchir Khraïef, Op.Cit, p. 32.
[25]Béchir Khraïef, Op.Cit, p. 45.
[26] Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, Coll. « Poétique », 1987, pp. 150-151.
[27]Ibid.
[28] « Là où la vie emmure, l’intelligence perce une issue. » (Marcel Proust, Le Temps retrouvé, 1922.)
[29] Léopold Sédar-Senghor, Anthologie de la nouvelle poésie africaine et malgache de langue française. Précédée de Orphée noir de Jean-Paul Sartre, Paris, Presses Universitaires de France, Coll. « Quadrige », 1948.
[30] Béchir Khraïef, Op. Cit, p. 10.
[31]Umberto Eco parle de la notion de perte sémantique : « Il y a des pertes dites absolues. Ce sont les cas où il est impossible de traduire, et si de tels cas se présentent, mettons, dans un roman, le traducteur recourt à l‘ultima ratio, la note en bas de page – laquelle ratifie son échec. Un exemple de perte absolue est le jeu de mots » (Dire presque la même chose. Expérience de traduction, (traduit de l’italien par Myriam Bouzaher), Paris, Grasset, Coll. « Livre de poche », 2006, p. 118.).
[32] Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, Coll. « Poétique », 1987, p. 299.
[33]Ibid., p. 295.
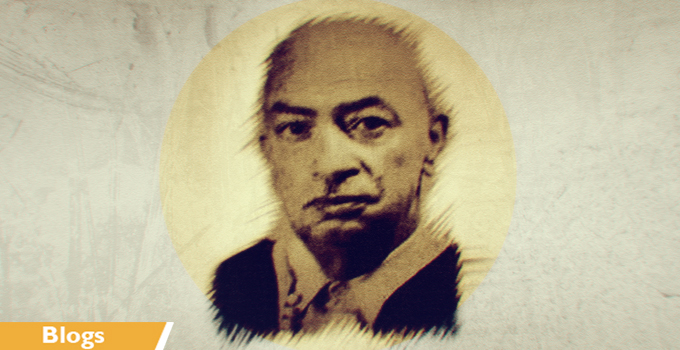





iThere are no comments
Add yours