Etat policier, mode d’emploi
Lire aussi :
La grande rue Bourguiba, dans le centre-ville de Tunis, se réveille sous une pluie soudaine. Des banderoles en rouge et blanc ceinturent les édifices de l’artère principale : « Une nouvelle ère avec le président Ben Ali »… « Avec Ben Ali, la Tunisie de demain ».
Source : El Watan (Alger), Edition du 7 novembre 2006 > Reportage.
Cascade de slogans mouillés par l’averse matinale glorifiant les « pertinents choix stratégiques et pleins de sagesse » du chef de l’Etat tunisien, à l’occasion de la commémoration du 19e anniversaire du « changement » : lorsque Zine El Abidine Ben Ali, ministre de l’Intérieur à l’époque, a destitué le président Bourguiba, le 7 novembre 1987, pour « raison médicale ». « On sent la crise ; en fait, ça fait longtemps que ça couve… Le régime est fragilisé, d’autant plus qu’il ne bénéficie plus de son ancien rôle stratégique de pôle stable entre deux pays instables, l’Algérie et la Libye », dit Mokhtar Yahiaoui, magistrat licencié de son poste pour avoir exprimé, dans une lettre ouverte adressée au président Ben Ali, en juillet 2001, son « exaspération envers l’état épouvantable de la justice tunisienne dans laquelle le pouvoir judiciaire et les magistrats ont été dépossédés de leurs prérogatives constitutionnelles ». Mokhtar Yahiaoui, président du Centre de Tunis pour l’indépendance de la justice (CIJ) et membre fondateur de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP), pense que l’étape actuelle est celle de « fin de régime ». « C’est un système clos, qui ne fait plus confiance à personne et qui ne domine la société que par ses appareils de répression », ajoute l’ancien magistrat qui vit sous surveillance policière, coupé d’internet et victime parfois d’agressions physiques, comme ce fut le cas, le 11 décembre 2001. Mais il reste optimiste : grâce au combat du CIJ, le principe de l’indépendance de la justice a été porté au cœur même du corps des magistrats. L’association des magistrats a fait élire une direction attachée à ce principe. Le pouvoir a réagi : bureau de l’association fermé, magistrats activistes mutés dans des régions lointaines, création d’une association « fantoche », envoi au Congrès mondial des magistrats de délégation tunisienne non représentative, etc. « Lorsque nous voulions envoyer des magistrats au Caire pour marquer notre solidarité avec le mouvement de protestation des juges égyptiens, l’ambassade d’Egypte a refusé de nous octroyer les visas », dit Yahiaoui pour illustrer la « solidarité arabe » ! « Toi, qui est étranger, tu as plus de droit qu’un Tunisien dans son propre pays… La police nous arrête même si on se dispute au téléphone avec notre petite amie… Ils sont durs ici les policiers », raconte un jeune diplômé en maintenance informatique au chômage alors que se prépare, au premier jour de notre arrivée à Tunis, de cauchemardesques mésaventures dans ce charmant petit pays touristique qui compte quelque 130 000 policiers pour 10 millions d’habitants et 30 000 prisonniers politiques. « Fais attention ; en tant que journaliste, tu seras surveillé », nous avait-on averti à notre départ d’Alger. Surveillé ? C’est peu dire.
Risques d’agression physique
D’abord, c’est le vol du téléphone portable par un groupe de jeunes voyous qui s’affichaient en fin de séjour aux côtés des équipes de policiers qui nous suivaient. Ensuite, ce sont ces trois groupes de « suiveurs » composés de cinq à six policiers en civils, portables collés à l’oreille, qui ne vous lâchent pas. Souvent, ils passent devant vous et parlent à haute voix au téléphone : « Il est là, il vient de sortir du café et il marche sur la grande rue. » A notre visite à Moncef Marzouki, à Sousse, un scooter, un véhicule avec des officiers de police à l’intérieur nous ont suivis toute une après-midi. Nous avons été arrêtés, fouillés et interrogés deux fois dans de « faux » barrages routiers. Dans le taxi collectif qui fait le trajet Sousse-Tunis, c’est carrément un des policiers — un gaillard chauve roulant les mécaniques — qui nous suivait avec son scooter qui prend place à côté. On se sent bien gardé en Tunisie. Chaque quart d’heure, il appelait sur son portable : « Il est à côté de moi. » Arrivé à Tunis en début de soirée, les alentours immédiats de l’hôtel, non loin de la rue Bourguiba, sont pris d’assaut par une douzaine d’agents en civil qui ne cachent pas leurs intentions. « Ils n’ont pas le droit de s’attaquer directement à vous, mais ils feront tout pour que vous perdiez votre sang-froid. Eviter aussi de marcher seul dans les petites artères ou la vieille ville, on ne sait jamais », dit un militant des droits de l’homme. Nous limitons alors nos déplacements à Tunis, en s’en tenant aux axes principaux et en regagnant l’hôtel dès la tombée de la nuit. Notre chambre d’hôtel est systématiquement fouillée à chaque fois qu’on s’absente. On fait mine de nous appeler à notre chambre puis s’excuser de s’être trompé de numéro. Dans la rue, au café, devant la gargote ou entre les allée d’une librairie, ils sont là, accrochés à leurs téléphones portables, questionnant le libraire, le vendeur de CD de musique que vous venez de consulter, vous fixant du regard, échangeant des consignes avec des jeunes portant casquette à la mode hip-hop et chaussures de sport, coordonnant les déplacements avec un motard en civil et un autre sur un scooter pour vous suivre au cas où vous prenez un taxi. C’est ainsi que pour prendre l’avion du retour, c’est un taxi de la « maison » qui nous prend en charge, suivi d’une voiture et d’un jeune en moto. Ils resteront avec nous jusqu’à l’embarquement, en ameutant également les policiers de l’aéroport. Ont-ils poussé leur zèle jusqu’à prendre l’avion à destination d’Alger ?
Adlène Meddi
Attention, risques d’agression caractérisée !
La crainte, nous avertissent nos contacts à Tunis, reste l’agression perpétrée par des hommes de main et maquillée ensuite en fait divers.
Ce fut le cas pour l’envoyé spécial du quotidien français Libération, Christophe Boltanski, en novembre 2005, à Tunis, alors que se tenait dans cette ville le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) : le 11 novembre 2005, dans la soirée, Boltanski a été agressé et poignardé dans le dos, à proximité de son hôtel, dans le quartier des ambassades de Tunis. Les agresseurs lui ont volé ses affaires, notamment ses carnets de notes, son téléphone et sa clef USB. Selon l’ONG Reporter sans frontières (RSF), Christophe Boltanski a tenté d’obtenir de l’aide de policiers tunisiens en faction devant l’ambassade de Tchéquie, mais ces derniers n’ont pas réagi. Les agresseurs ont, par ailleurs, mystérieusement disparu dans un quartier tout particulièrement quadrillé par la police. De même, un policier tunisien, venu quelques heures plus tard voir le journaliste à son hôtel, a refusé d’enregistrer sa plainte. Le jour même de l’agression, Christophe Boltanski signait dans les colonnes de Libération un article intitulé « Manifestants tabassés par la police à Tunis » dans lequel il relatait le passage à tabac par des policiers tunisiens de militants des droits de l’homme qui tentaient d’organiser une manifestation de solidarité avec sept personnalités de l’opposition qui observent une grève de la faim depuis le 18 octobre dernier. Plus récemment, deux journalistes tunisiens, Slim Boukhdir et Taoufik Al Ayachi, ont été passés à tabac, le 16 août 2006, alors qu’ils se rendaient chez Samia Abbou, l’épouse du célèbre avocat et cyberdissident Mohammed Abbou, afin d’y réaliser une interview. Un important dispositif de police est, en effet, déployé autour de son domicile depuis qu’elle a mené, le 13 août, une grève de la faim pour demander la libération de son mari, selon RSF qui donne plus de détails : « En arrivant aux abords du domicile de la famille Abbou, Slim Boukhdir, journaliste au quotidien Al Chourouk et correspondant à Tunis du site internet de la chaîne Al Arabiya, ainsi que Taoufik Al Ayachi, journaliste de la chaîne de télévision Al Hiwar qui émet depuis l’Italie, ont été pris à partie par une douzaine de policiers qui les ont battus. La caméra de Taoufik Al Ayachi a été confisquée tandis que Slim Boukhdir réussissait malgré tout à entrer chez Samia Abbou. Il a été appréhendé à sa sortie puis emmené à l’écart pour être tabassé une nouvelle fois. »
Adlène Meddi
Lire aussi :« La dictature, une occupation interne »


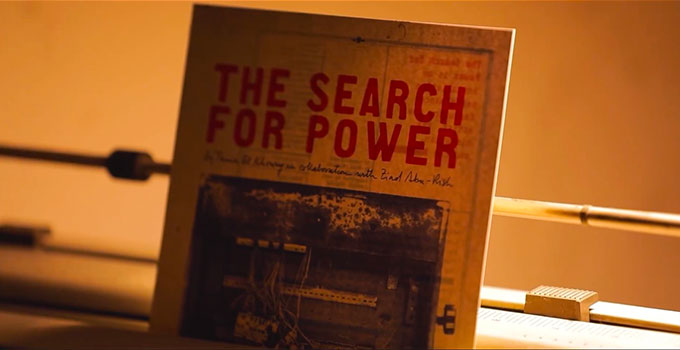

iThere are no comments
Add yours