Sans autre grâce que celle du tâtonnement, les premières secondes d’Apparition offrent au regard la calme inquiétude d’une blancheur maculée. C’est une espèce de projection qui aurait peut-être à voir avec les fortes impressions lumineuses auxquelles nos yeux doivent s’habituer au réveil. On capte à peine des grains qui ne sont pas en attente de spectre, ou qui font commencer l’attente de quelque chose qui n’arriverait peut-être pas, avant qu’en un tour de main l’artiste ne vienne faire basculer cet étrange bain lumineux en un milieu ou une chambre de projection. On observe alors deux mains encadrant un élément rectangulaire si fortement éclairé qu’il nous aveugle sur son contenu. Nous voilà donc, du moins en apparence, devant un humble dispositif de captation.

Perception saturée
Il y a en effet, dans les vidéos d’Ismaïl Bahri, non pas le même protocole d’expérience, mais les coordonnées d’un même problème. Ces coordonnées sont celles d’une perception saturée, à travers une projection obstruée. À distance de l’objectif, la mise au point se fait ici sur l’élément rectangulaire. Il s’agit, à première vue, d’une surface surexposée au regard de laquelle voir équivaut à ne rien voir : elle donne l’impression d’une nappe sans mémoire, sans image et sans ombre. Là où Foyer se peuple de voix grâce à un bout de papier blanc, alors que Revers dépeuple au contraire une image en la froissant du bout des doigts, l’élément d’Apparition secrète les virtualités d’une révélation. Ce simple dispositif sert à mettre à l’épreuve la capacité d’une perception à rendre perméable son médium, à interroger sa médialité par une sorte de renversement d’attitude : le tâtonnement d’une main qui veut voir et de l’œil qui cherche à toucher.
Cette vidéo d’Ismaïl Bahri met à l’épreuve la « myopie » qu’il évoque souvent pour décrire sa démarche. La surexposition est si forte qu’elle exige ici de la perception – en l’occurrence, celle de l’artiste-observateur – un relais de motricité. Avec l’interposition de ses deux mains qui possèdent l’intelligence des surfaces, le geste de toucher rompt l’accès de cécité dont nous sommes saisis. Mais il s’agit d’une tactilité négative, comme exaltée d’être privé du secours de la vue. Si elle sert à faire place au visible, cette tactilité fait mine de dépoussiérer une surface. L’impression est curieuse : seules les ombres projetées par les mains sur cette surface révèlent ce qui est enfoui par la lumière. Entre la matérialité de l’une et la surexposition de l’autre, une tension se fait jour là où notre perception reste aux aguets de ce qui viendrait se dévêtir de son apparence. Sur le recto, on y perçoit une foule cadrée à mi-corps, des drapeaux, un jour de grand soleil lors d’un rassemblement. Il fallait, par le même tour de main, que l’artiste retourne la feuille pour découvrir ce qui est consigné sur le verso : le 20 mars 1956, c’est le jour de l’Indépendance de la Tunisie, et la photo d’archive en couleurs fut prise, lit-on, par un photographe inconnu. On dirait une fiction d’image, restée au secret d’un tiroir de famille.

Discrète dialectique
Filmée par une caméra statique, Apparition susciterait une discrète dialectique : à la distance optique s’impose une sorte d’adhérence, et à ce mouvement d’approche répond quelque chose comme une déprise, comme si pour voir il fallait toucher. C’est dans ce mouvement que quelque chose s’organise en fait, un état de l’ombre s’y découpe, n’acceptant de céder un droit de passage à la lumière que pour partager son territoire. C’est le théâtre d’étranges ombres mouvantes : à la surface, des fragments montent qui naissent du filtre de la nuit, puis ces ombres font apparaître des silhouettes, des corps dont les contours et les détails photographiés en couleurs gagnent difficilement en netteté, avant de s’établir dans l’état et dans le temps où ils ont été captés. Le blanc lumineux cède peu à peu la place à des visages dont la pression des regards, proches et lointains, au milieu du cadre comme à ses bords, se focalise sur l’objectif. Ce qui se passe en effet ne serait rien d’autre qu’une manière de révéler une image en résistant à l’image elle-même.
Mais révéler l’image, ici, ne serait-ce pas confier aux mains la tâche d’inscrire une différence, de travailler ou de laisser opérer une tension ? Les mains chez Ismaïl Bahri sont certes l’opérateur d’un dépli, d’un écart dans le contact ; elles sont l’agent en faveur duquel quelque chose apparaît ou disparaît. Ici, elles nouent un rapport paradoxal entre l’ombre des mains et la perméabilité de la photo ou sa résistance à la surexposition. Négativement, le mouvement des mains se déploie progressivement en latéral, se déplaçant avec tact et grâce pour balayer la surface. Sans l’altérer, elles touchent le corps de l’image, avec une savante subtilité, dans une attention quasi-médicale, comme si elles déclenchaient le mécanisme de révélation par simple contact. Avec pour effet de tirer du néant des tranches d’opacité où le regard reconnaît au fur et à mesure le contenu invisible. Synchrone qu’elle est avec ce que les ombres laissent apparaître, Apparition se déroule délicatement, unie à ce qui apparaît comme l’est un corps s’affectant de son milieu.
Convoquer l’ombre
Peut-être est-ce là un geste qui n’est pas sans évoquer le développement d’un instantané. La vidéo de Bahri ménage un effet d’ordre comparable à celui de la camera obscura, à taille humaine. Avec le dispositif de la chambre noire, un spectacle se déroulant à l’extérieur est reproduit dans un espace clos, dans l’obscurité duquel le spectateur est inclus. La photographie ici filmée, a le statut de ces lanternes bénéficiant d’un éclairage qui en avive les ombres et lumières. Pris en charge par une altérité, l’effet d’Apparition est ici prescrit par la tension entre une lumière qui aveugle et une opacité qui révèle. Convoquer l’ombre, ce serait un geste qui sollicite les puissances discrètes d’un négatif, ou son dérivé radiographique, pour le projeter dans le présent de sa venue au visible. Convoquer l’ombre, ce serait une façon de se demander ce qui, de la mémoire, peut revenir à la faveur d’une affection. Ou ce qui, d’une image, peut venir à l’image.
De ce renversement d’attitude suscité par Apparition, une phénoménologie ne dira pas autre chose : pour que l’image apparaisse, il faut la toucher. La vidéo fait éclore le paradoxe d’une visibilité qui, sans se suffire à sa transparence, en appelle à une opacité pour apparaître. D’une simplicité confondante, le geste d’Ismaïl Bahri rappelle que le visible surgit à la pointe d’un tact, d’une caresse. S’il est banal que le toucher supplée à la vue, il l’est moins de supposer que le tact rend possible le perçu. Plus que toute autre dimension, l’ombre déposée d’une main permet d’entrevoir le plus invisible : le temps. Comme s’il fallait qu’une ombre s’étende sous l’image pour que celle-ci se souvienne et que s’y recompose, du bout des doigts, une mémoire hors de portée.

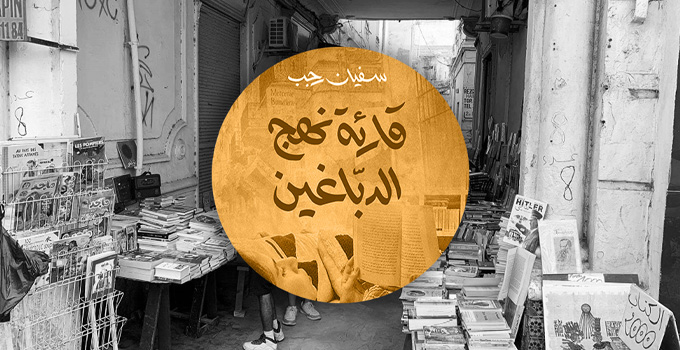



iThere are no comments
Add yours