Du 30 avril au 2 mai, dans un économat datant du début du XXème siècle, l’association Siwa plateforme a offert la découverte de La ligne d’une tentation, la restitution d’une résidence artistique qui a eu lieu à Redeyef. Des artistes tunisiens, français et irakiens ont, pendant quinze jours, expérimenté, travaillé et créé avec des habitants de la ville minière.

Plongée dans une expérience artistique, poétique, humaine qui confirme que la culture est un outil de développement et une piste à explorer pour sortir du désastre. « La culture, c’est ce qui nous permet de parler d’égaux à égaux avec n’importe quel étranger et intellectuel qui vient dans notre ville », murmure Issa Mabrouk, 24 ans, ce dimanche 1er mai sur la place de l’Économat. Tout autour de lui, une foule d’une centaine de personnes forme un cercle et regarde une pièce de théâtre de rue dont la troupe est constituée de natifs de la ville et d’Irakiens. Plusieurs moments très puissants de cette pièce qui retrace l’explosion de l’État irakien. Un thème parfait pour cette ville située aux confins d’un État démissionnaire, dans ce paysage aux teintes phosphatées post-apocalyptique. Mais l’essentiel reste la réception de la pièce par ce public qui vit les scènes une par une avec une intensité non simulée. Ensuite se jouera un concert de rap de Black Unit, un duo de rappeurs de Redayef, Galla3a et Jojo M à la prose et au flow impressionnant.

Quelque chose est en train de se jouer
Quelque chose est en train de se jouer ici et il ne s’agit pas seulement de théâtre ou de culture. La reconquête de la ville : « maintenant que nous avons réinvesti cet économat, il nous faut en prendre soin et multiplier les activités ; le rêve commence à peine ! » clame ; en pleine réunion, El Aid Bouoni, 51 ans, homme de théâtre, militant associatif et employé de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), originaire de Redeyef. La pièce qui accueille la réunion est remplie de gens de nationalités multiples et aux horizons divers, mais la majorité de l’assemblée est composée d’habitants de Redeyef. L’atmosphère est animée, joyeuse, l’émotion est palpable. Dans ce Far West tunisien, une expérience communautaire et artistique se conjugue au présent depuis 5 ans. Il y a encore trois mois, cette salle, un ancien dépôt de l’Économat reconvertie aujourd’hui en petite cafétéria et salle de repos, était, comme le reste de la bâtisse, à l’abandon. Il aura fallu trois mois de travail, l’énergie d’une vingtaine de jeunes encadrés par Chams, membre actif de Siwa, pour réhabiliter l’espace. L’Économat appartient à la CPG qui l’a mis à disposition de l’association. Il était dans un état tellement déplorable qu’il aura fallu plus de dix transports de déchets en camion pour le vider des ordures et du phosphate qui l’encombraient. Une expérience qui a offert l’occasion à ces jeunes, navigant pour la plupart entre petits boulots et périodes de chômage, de s’approprier cet espace et un nombre incroyable de compétences.

Congé sans solde et autogestion
Chams, c’est Chamsedine Zitouni, chef du personnel de la bibliothèque de Sousse et responsable logistique de Siwa. Il a pris un congé sans solde de plus de deux mois afin de diriger cette vaste entreprise, le tout quasiment sans financement et avec l’ambition incroyable d’apprendre à ce groupe à tout faire soi-même. « On n’avait pas d’argent, il s’agissait donc de faire d’une pierre deux coups : réhabiliter cet espace et apprendre aux jeunes des métiers et les responsabiliser », explique-t-il. Pari réussi. Tout a été refait par ce petit groupe d’une trentaine de personnes. À l’aide de tutoriels sur internet et de matériaux de récupération, ils ont tout refait. Ils ont tous beaucoup appris, peinture, menuiserie, verrerie, ferronnerie, électricité, eau… « Le plus long a été le travail de récupération, précise-t-il, avant d’ajouter maintenant, ces jeunes savent ce que cela a couté de faire ces cendriers, cette table, ils respectent ce lieu et ont acquis une nouvelle considération pour le travail ». Bochra Triki, chargée de production de Siwa et Fatma Zammouri, coordinatrice pour Siwa, énumèrent les activités qui sont et seront au cœur de la vie de l’Économat. « En sus des résidences d’artistes qui ont lieu une à deux fois par an, il y a des activités de cinéma, de photographie, de musique. Il s’agit d’identifier ceux qui ont l’envie et de les aider à déceler leur talent et leurs compétences » expliquent-elles.
Pour cela, les artistes de Redeyef ou les artistes associés donnent de leur temps et travaillent régulièrement avec les gens qui viennent aux rencontres.
Dorénavant il s’agit pour eux de faire de l’Économat le centre d’une vie culturelle autogérée, non plus réglementée par des horaires arbitraires dictée par un gardien tatillon et loin de la surveillance ressentie négativement dans les espaces plus institutionnels. Pour l’heure, le rêve de ce petit groupe serait de trouver 10 000 dinars afin de refaire la toiture et de réparer les canalisations, ce qui permettrait d’avoir des toilettes. À terme, une rénovation totale de l’espace, comprenant la toiture, les canalisations, l’étage et la cave couterait 150 000 dinars, mais permettrait à ce lieu de devenir une résidence d’artiste et un espace de diffusion. L’enjeu sera de réussir à créer une micro-économie alternative ; la construction d’un café associatif avec une bibliothèque et d’un ciné-club est également à l’étude.

Poétique de la ville
Depuis que le lieu est là, les gens commencent à comprendre ce que l’on fait ici, ils commencent à s’impliquer, ils viennent. Pour nous, il s’agit de faire avec ce qui est et de laisser advenir les choses.Yagoutha Belgacem, Présidente de l’association Siwa plateforme
L’expérience de la poétique dans la vie Yagoutha Belgacem arrive à Redeyef en 2011. Présidente de l’association Siwa plateforme, basée en France, elle mène également des projets artistiques en Irak. Pour elle, Redeyef c’est la Tunisie qui la touche, celle qui a donné de son sang en 2008 et pendant l’hiver 2010-2011, celle qui se révolte. Lorsqu’elle vient pour la première fois, en 2011, il ne s’agit pas encore d’un projet, elle n’a pas d’objectif. Il s’agit de partager quelque chose. « Une poétique plutôt que de l’artistique affirme-t-elle, quelque chose d’expérimental et d’évolutif, pas du figé ». Rapidement elle s’entoure d’un noyau dur d’artistes associés, Fakhri El-Ghezal, Atef Maatallah et Imen Smaoui qui la suivront et s’inscriront dans le paysage de Redeyef (littéralement pour Atef avec ses fresques que l’on retrouve dans la ville). D’autres artistes suivront le mouvement et viendront travailler avec le groupe de Redeyef, Zied Meddeb Hamrouni (Shinigami San), Zein Abdelkefi (Hayej). « Tous c’est fait de manière organique, naturelle », explique-t-elle comme pour justifier le fait que les choses aient pris leur temps pour s’installer. Ici, cela se sent, la temporalité est différente, la perspective n’est pas de venir brusquer les choses, les gens, la vie. « C’est un processus qu’on vit sur une dizaine d’années », confirme-t-elle. Il s’agit de recréer une communauté à partir d’une poétique. Le groupe s’est constitué au départ des plus marginalisés. D’après Yagoutha, c’est parce qu’ils étaient ceux qui erraient dans l’espace public qu’ils ont été les premiers à s’approcher. Ensuite sont venus ceux que la culture et la pratique artistique attiraient. Maintenant, on ne les distingue plus, ils forment un groupe qui continue de s’élargir. Pour elle l’Économat est une communauté ouverte. C’est un geste politique, car cela créé un sentiment de responsabilité » dit-elle. Et d’ajouter que « depuis que le lieu est là, les gens commencent à comprendre ce que l’on fait ici, ils commencent à s’impliquer, ils viennent. Pour nous, il s’agit de faire avec ce qui est et de laisser advenir les choses ».
Imen Smaoui, danseuse, chorégraphe et artiste associée au projet témoigne qu’elle a assisté à une transformation chez les participants. « Le plus impressionnant c’est l’apprentissage de l’écoute. Et cela se ressent à travers les pauses, le silence, confie-t-elle, dorénavant il y a un véritable échange ». Pour Imen, l’expérience a offert aux participants l’occasion de changer le rapport à leur corps : « c’est peu, mais c’est énorme. Maintenant, il n’y a plus de gêne à se regarder dans les yeux, cela peut apparaitre un détail, mais ça n’en est pas un, c’est majeur ». Autre différence notable, la rigueur : « au début c’était un désordre incroyable, raconte-t-elle, maintenant il y a de la rigueur et de l’endurance, de l’autodiscipline dans les ateliers de travail ». Un regret toutefois, le manque de présence féminine, très remarquable. Pour Imen, cela s’explique par l’absence de lieu dans un premier temps. Elle nous raconte également qu’il y a eu une présence féminine régulière, faible, mais régulière.

Brecht sur la montagne
Laurence Chable, comédienne et co-responsable de la Fonderie, nous explique que sa présence à Redeyef, de même que celle de François Tanguy et de Patrick Condé, est née d’une rencontre fortuite. De passage en Tunisie en 2014, ils visitent Redeyef et découvrent le projet. Ils décident d’y revenir l’année suivante en résidence. Ils travaillent en 2015 avec le groupe des participants à la mise en espace du Cercle de Craie Caucasien de Bertolt Brecht à travers une promenade théâtrale dans les montagnes environnantes. La représentation attirera plus d’une cinquantaine de personnes de Redeyef. En octobre 2015, ils reviennent pour une semaine de résidence à Tunis, hébergée par l’IFT, avec les participants initiaux et des rappeurs. Et puis enfin, les voilà de retour à cette occasion. Ils ont tenté de mettre en place un chœur de femme, mais la présence régulière des participantes a été légèrement compliquée. Toutefois, l’expérience s’est avérée satisfaisante, tant pour les participantes que pour les comédiens. Pour elle, l’enjeu est d’arriver à faire en sorte que l’économie culturelle s’installe et que les participants arrivent à sortir de la dépendance des petits boulots et de la CPG.
L’expérience du spectateur s’achève, il est temps de reprendre la route, vers la capitale, vers l’est, vers le nord. Cette route que se partagent contra et harass [garde nationale], cette route de l’infamie et de la démission de l’État. Au fin fond de cette route, là où l’on désespère que l’aide ne vienne, les gens s’organisent, s’associent, recréent du lien et de la communauté. L’art, la poétique, la culture structurent, cristallisent, lient. Peut-être est-ce là le seul espoir qui reste à nos territoires.

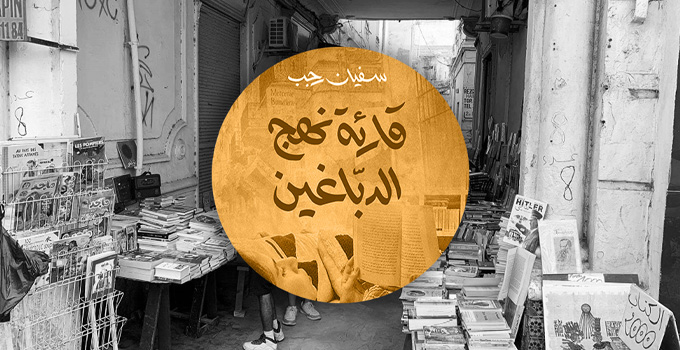



iThere are no comments
Add yours